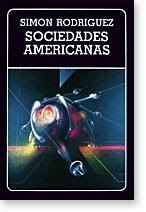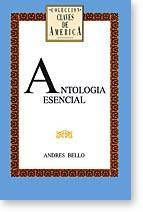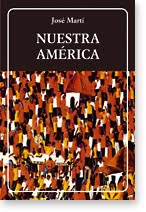(Publicado en la Revista "Cités", Francia, 2006)
Miguel Angel Pérez Pirela
La soi-disant impasse que le Venezuela vit aujourd’hui ne peut pas être abordée sans une prise en compte préalable du chemin démocratique que le pays a parcouru jusqu’à la situation qu’il connaît de nos jours. Cette situation est l’expression d’une division radicale de la population en deux parties, « chavistas » et « anti-chavistas »[1].
En effet, comment expliquer ce paradoxe de la société vénézuélienne, qui est passée d’une indifférence politique remarquable, caractérisant presque toutes les années de son régime démocratique, à une implication politique comparable à la ferveur que l’Amérique du Sud a connue dans les années 60?
1. Le « Grand Venezuela »[2]
Le Venezuela commence son parcours démocratique le 23 janvier 1958 avec la chute du dictateur Marcos Pérez Jiménez. Depuis ce jour, le pays a vécu sans interruption dans un régime démocratique[3]. La vie démocratique vénézuélienne, marquée par un « certain calme », surtout pendant les années 60 et 70, fait du Venezuela un cas exceptionnel dans la région, du fait de son éloignement de la vague de dictatures qui prend d’assaut le continent.
Mais l’originalité du cas vénézuélien ne se limite pas, durant cette période, à sa situation politique. Du point de vue économique, le pays connaît aussi d’importants changements qui renforcent cette quiétude politique. Le changement capital, c’est la nationalisation du pétrole en 1977, opérée par le président Carlos Andrés Pérez. Pendant ce temps, les prix internationaux du pétrole connaissaient une hausse importante, rendant ainsi possible une croissance économique.
La situation politique et économique de la société vénézuélienne, si elle éloigne le pays du drame des dictatures, le tient à distance du même coup du rendez-vous historique du continent avec les revendications sociales de cette période.
Cette situation économique particulière consolida alors un phénomène qui existait déjà dans le pays : l’indifférence de la société à l’égard de la vie politique. Mais cela ne voulait pas dire pour autant que les vénézuéliens n’appartenaient pas à des partis politiques. Depuis 1958, les individus et les familles s’inscrivaient généralement dans l’un des deux partis au pouvoir : « Acción Democrática » et « COPEI »[4]. Mais la similitude de leurs projets conduisait les électeurs à choisir plutôt en fonction du charisme des candidats que de leurs lignes politiques.
On peut dire qu’il y avait à cette époque un « déficit de conscience politique » qui, à partir des années 90, commença à changer. Le point de rupture avec ce mode de vie et avec cette absence d’intérêt politique eut lieu le vendredi 18 février 1983, l’une des dates les plus significatives de l’histoire du pays. Le matin du célèbre « vendredi noir »[5], les vénézuéliens se réveillèrent dans un pays doté d’une économie beaucoup plus faible qu’ils ne le croyaient. Mais quel a été le principal effet de ce « vendredi noir» ?
Du point de vue politique, ce fut la prise de conscience de la grave erreur qu’avait été la nationalisation du pétrole, laquelle s’était déroulée de manière précipitée par le rachat coûteux aux compagnies étrangères de ce qui, par un mutuel accord, devait être donné au Venezuela quelques années plus tard. La dévaluation de la monnaie et la crise économique finissent par mettre en lumière la corruption existante : entre 1974 et 1983, les cas de corruption furent très nombreux.
Les gouvernements de l’époque avaient mélangé de façon dangereuse « un capitalisme honteux et un socialisme pudique »[6]. Paradoxalement, pendant ces années de bonheur économique, le Venezuela avait entretenu une dette intérieure et extérieure démesurée. Il a fallu constater également les dégâts entraînés par une économie fondée sur la monoproduction : avec l’arrivée du pétrole, le Venezuela, qui au début du siècle basait son économie sur la production de cacao et de café, avait mis fin à l’exploitation de la terre, ce qui avait conduit la population à se ruer sur les grandes villes. Les conséquences furent l’exode rural et la surpopulation urbaine, ceintures de pauvreté dans les grandes villes, délinquance, etc.
Mais le « vendredi noir » ne se limita pas à faire ressortir une difficile réalité de facto. La situation que nous avons décrite, et qui se prolongea jusqu’en 1983, forgea dans le pays une réalité parallèle, que l’on pourrait appeler symbolique.
2. La classe moyenne et le symbolique
Les conséquences les plus déchirantes du « vendredi noir » se manifestent dans le domaine symbolique. Aujourd’hui le Venezuela est divisé en deux factions symboliques, en ce sens que cette division ne traduit pas une division – de facto – des classes. La division typique des classes telle qu’on la trouve chez Marx (bourgeoisie/prolétariat) ne permet pas ici d’expliquer la réalité vénézuélienne.
Du point de vue symbolique, les importantes différences économiques que l’on constate dans le pays ne traduisent pas seulement à une disjonction dans les faits entre (très) riches et (très) pauvres, comme on le pense souvent. Il existe une zone intermédiaire délicate, formée par une classe moyenne (entrepreneurs, professionnels, commerçants, anciennes familles de la classe moyenne, professions libérales, etc.), qui avait connu une situation très stable du point de vue économique pendant les années du « Grand Venezuela », mais qui, à partir du « vendredi noir » et tout au long des années 80 et 90, fut sévèrement touchée par la gravité de la situation économique. En réalité, cette classe moyenne se trouva déclassée, même si, symboliquement, elle continua et continue toujours de revendiquer une réalité économique désormais disparue.
En effet, les conflits que vit aujourd’hui le pays nous révèlent un phénomène rarissime : la vie économique réelle de la classe moyenne ne traduit pas son sentiment d’appartenance. Cette classe, comme avant le « vendredi noir », continue de s’identifier économiquement et politiquement avec la classe élevée. Cela montre comment la situation de facto peut se transformer sans que la réalité symbolique ne souffre de modification. Au Venezuela, après le « vendredi noir », une partie de la population semble avoir perdu le support réel de son identification politique, économique et sociale d’auparavant, tout en continuant à agir comme si le changement n’avait pas eu lieu.
La classe moyenne vénézuélienne des années 60 et 70 se caractérise aujourd’hui par une précarisation qui la transforme en classe « moyenne-basse » ou plutôt en classe « pauvre-haute ». De nos jours, l’intention politique qui mobilise l’ancienne classe moyenne est claire : ne jamais devenir « classe pauvre » (clase baja)[7]. C’est précisément dans cet idéal d’identification avec une image du passé que réside le décalage symbolique propre au cas vénézuélien. À partir de cette constatation, on voit que la question de la place occupée par le président Chávez est supplantée par un problème plus grave : l’embarras identitaire d’une partie de la société.
Ici nous devons prendre en considération un élément supplémentaire. Le problème symbolique lié à l’appartenance a été amplifié par la plus puissante des forces du pays : la télévision. Au Venezuela, la télévision est déterminante pour le mode de vie, la culture, la langue et les mœurs.
Pendant trente ans, les deux principales chaînes de télévision (Venevisión et RCTV) se sont engagées dans une compétition pour l’audience, avec pour seul gagnant les telenovelas (les feuilletons). Dans la structure narrative des feuilletons, le riche et le pauvre sont habituellement unis par un lien sentimental, qui de manière très relative les rend égaux. Mais cette égalité représente plutôt une montée de la classe pauvre vers la « classe haute » (clase alta) que l’inverse.
Pourtant, on trouve dans ces feuilletons quelque chose que l’on pourrait appeler une logique de « reflet/pérennisation ». Les drames présentés par les feuilletons contiennent toujours le reflet des distinctions très nettes de facto entre les classes sociales. Souvent, les rôles des protagonistes ne correspondent pas à des distinctions fondées sur l’intrigue, sur le caractère des personnages ou sur leur psychologie, mais plutôt à des distinctions entre les classes sociales. Dans la structure du feuilleton, il y a toujours une différenciation radicale entre, d’un côté, l’employée de maison, la famille et le quartier pauvre et, de l’autre côté, la fiancée ou l’épouse riche, la famille et le quartier riche. Ces distinctions ne se contentent pas de montrer une réalité existante, mais la reproduisent et la pérennisent dans le domaine symbolique.
Dans le phénomène des feuilletons, nous pouvons voir ainsi une des causes les plus éclatantes de l’explosion de haine et de radicalisme qui secoue les deux parties symboliques de la population : l’une ayant des complexes d’infériorité et se sentant exploitée, l’autre ayant des complexes de supériorité et se sentant déclassée. C’est ainsi que se pérennisent deux classes très différentes, unies seulement soit par un lien de servitude de facto (une classe exploite l’autre), soit par un lien sentimental/symbolique (feuilletons).
3. La classe pauvre et la rupture du symbolique
Après le « vendredi noir », un certain réalisme s’abattit sur le pays. Les différences de facto se firent plus tangibles. La majorité pauvre de la population, à la différence de la soi-disant classe moyenne, réussit pour la première fois à percevoir dans toute leur ampleur les différences entre les classes. La prise de conscience de ces inégalités réelles ne tarda pas à prendre la forme de visions politiques hétérogènes, radicalement différentes de ce qui quelques années auparavant, en raison du « Pacte de Punto Fijo »[8], semblait constituer une seule et même réalité politique.
Le mécontentement qui aboutit aux manifestations – El Caracazo – de 1989 n’avait été pris en compte ni par le gouvernement, ni par le parlement, ni par les partis politiques. La solution qu’adopta le président Carlos Andrés Pérez fut fondée sur la violence et la répression. La riposte arriva trois ans après, le 4 février 1992 : le Venezuela vivait son premier coup d’État, après trente-quatre ans de démocratie. Le leader de cette insurrection militaire, menée non pas par des haut cadres de l’armée mais par de jeunes officiers mécontents, fut le lieutenant Hugo Chávez Frías qui, quelques années plus tard, devait remporter les élections présidentielles.
À travers une action anti-démocratique, le jeune commandant Hugo Chávez Frías a montré et démontré l’imminence de la maladie du système démocratique vénézuélien. Cette action a suscité, dans tout le champ politique vénézuélien, une prise de conscience de l’imminence effective de cette maladie. À partir de ce moment, on peut commencer à parler de la possibilité de l’existence d’une opposition réelle dans le pays.
Une fois sorti de prison[9], Chávez se lança dans la course à la présidence, en s’appuyant sur un discours qui ne cherchait pas seulement à égaliser les différences de facto entre les classes, mais tentait aussi d’établir des vraies différences symboliques. La force du « premier Chávez » était fondée sur le symbolique : il essaya de faire sentir aux vénézuéliens pauvres leurs différences politiques vis-à-vis de la classe haute. Ces différences avaient été dissimulées jusqu’alors par la logique des feuilletons, au point de vue social, et par le « Pacte de Punto Fijo », au point de vue politique.
Le discours de Chávez n’était pas uniquement centré sur la manière d’éliminer la pauvreté (sur le comment), c’est-à-dire sur des réformes visant à transformer l’éducation des pauvres, leur situation économique, la sécurité sociale, etc. Le changement que Chávez vise alors à instaurer passe aussi par une transformation de la vision que les pauvres ont d’eux-mêmes : il tente de les faire accéder à la conscience de leur appartenance à la classe pauvre. Chávez n’essaye pas seulement de changer les distinctions de facto riche-pauvre, mais comprend que c’est à partir de cette conscience symbolique de soi que les pauvres pourront changer la réalité de facto, et seront dès lors en mesure d’en finir avec l’acceptation passive des différences réelles.
Le candidat à la présidence arrive au pouvoir en gagnant les élections de 1998 avec une majorité écrasante, grâce à la prise de conscience identitaire qu’effectuent aussi bien les classes pauvre-haute et pauvre-pauvre que la classe pauvre-indigente, et qui les unifie alors en un groupe largement majoritaire.
Cependant, le premier vrai résultat politique n’est pas le triomphe aux élections, mais plutôt ce qui a constitué la prémisse de ce succès: l’écroulement des anciens partis politiques. L’opposition directe et virulente de Chávez à ces partis crée un « effet dominos » : les partis tombent les uns après les autres. Chávez démontre ainsi que, face à une vraie opposition politique, les partis traditionnels sont dépourvus d’armes démocratiques. Pendant quelques mois, le nouveau président ne rencontra pratiquement pas d’opposition. Dans le pays, il prit la tête d’une majorité fondée sur un consensus symbolique qui réunit une large partie de la population, à savoir, l’ensemble des classes pauvres. Comment expliquer alors la division radicale qui se mit à sévir au Venezuela quelques années plus tard ?
4. Le rôle de l’opposition
Au moment de la disparition de l’opposition politique qui avait été représentée par les anciens partis politiques (AD, COPEI), la place, laissée vacante, est prise par un autre genre d’opposition. Quelques mois après son élection, Chávez doit faire face de manière imprévue à des opposants très puissants qui contestent ses réformes législatives, sociales, politiques et économiques, parmi lesquelles les plus importantes sont la reforme agraire, la loi sur la pêche et la restructuration de PDVSA[10]. Les revendications de cette opposition sont d’abord d’ordre économique, et ne deviennent à proprement parler « politiques » que dans un deuxième temps. Mais cette fois, les opposants ne se trouvent pas insérés dans une logique de partis politiques.
Le siège de cette opposition est l’ensemble des médias privés (constituant la majorité des médias). C’est ainsi que le lieu « spatio-temporel » et « idéologique » de ses revendications est, d’une certaine façon, encadré et légitimé par les chaînes de télévisions et les journaux. En outre, derrière l’apparente cohésion de cette opposition, se combinent plusieurs éléments hétérogènes de la vie politique et sociale du pays : il serait impossible d’essayer de leur trouver une ligne politique commune ou un projet politique réel. Là se trouve sa véritable faiblesse. Ce qu’on appelle l’opposition se caractérise par l’utilisation d’un discours politique négatif. Jusqu’à aujourd’hui, cette opposition n’a pas présenté un seul véritable plan de gouvernement alternatif à celui de Chávez. Sa seule proposition politique est la démission de Chávez.
Quelle leçon pouvons-nous en tirer ? Il apparaît tout simplement qu’en trente-cinq années de démocratie, le Venezuela n’a jamais connu de véritable opposition démocratique. Plusieurs faits l’attestent : le « Pacte de Punto Fijo » s’étendant de 1958 à 1998 ; l’écroulement de AD et COPEI[11] avec l’élection de Chávez ; enfin, l’émergence de l’opposition économique, qui est allée jusqu’à réaliser un coup d’État le 11 avril 2002, dissolvant du même coup le Congrès et tous les représentants élus, et proclamant Pedro Carmona, président de FEDECAMARAS, président de la république[12].
Dans le fonctionnement de la démocratie du pays, l’opposition a toujours été soit « un minimum quasi cérémonial », soit un « démolisseur » de concurrents politiques[13]. C’est en ce sens qu’il est désormais urgent de repenser le rôle de l’opposition dans la vie démocratique. En effet, l’absence d’une vraie opposition politique dans le pays a conduit à une violence d’un nouvel ordre: la violence symbolique.
5. Le totalitarisme du symbolique
Aujourd’hui au Venezuela, les divisions classiques de facto entre les classes ne sont plus prises en considération dans le domaine du politique, car Chávez et l’opposition ont compris que l’appui du peuple vénézuélien en politique ne dépend pas de son milieu social et économique, mais bien plutôt du milieu avec lequel il s’identifie. La guerre politique vénézuélienne se fonde sur le problème de l’appartenance.
La création de l’identité dépasse souvent la réalité de facto pour se constituer en réalité symbolique. La réalité de facto est alors déterminée par mon appartenance, par le « je viens d’où ? », tandis que la réalité symbolique répond plutôt à la question du « je me sens d’où ? ». C’est à ce moment précis que le symbole peut surgir en tant que réalité remplaçant la réalité factuelle.
Comme on l’a déjà affirmé, la construction du mouvement de masse qui a porté Hugo Chávez à la présidence s’appuie sur un travail politique d’identification de 80% des Vénézuéliens (de la classe pauvre-haute, pauvre-pauvre, pauvre-indigente) à leur propre situation factuelle. Le discours politique conduisant à cette identification se fonde sur des accusations portées contre les anciens partis, contre la vie politique d’alors, contre certaines fractions de la société et même contre la façon dont a été racontée l’histoire vénézuélienne.
Pour sa part l’opposition a mené jusqu’à ses dernières conséquences une méthode politique/médiatique très active visant à changer symboliquement la distribution de facto des classes sociales dans le pays. Elle cherche à faire sentir positivement au plus grand nombre possible de Vénézuéliens qu’ils font partie de la classe moyenne, dans le sens que ce terme avait avant le « vendredi noir » ; et à faire sentir négativement aux chavistes qu’ils font partie de la classe pauvre-indigente.
Pour parvenir à ses fins, l’opposition utilise le même modèle que celui que l’on présente dans les feuilletons, c'est-à-dire la pérennisation de très fortes différences sociales, unifiées par une synthèse sentimentale, qui, transposée dans le domaine politique, n’est plus l’amour entre riches et pauvres des feuilletons, mais l’union de tous les Vénézuéliens contre le « tyran Chávez ». Le conséquence en est qu’une partie de la population devient victime ou actrice d’une haine nouvelle et d’une peur infondée à l’encontre d’une dictature chaviste : deux passions qui ont été d’une certaine façon produites par les médias.
L’impasse et les luttes politiques vénézuéliennes sont donc principalement d’ordre symbolique. Le paradoxe vénézuélien veut que l’engagement politique aujourd’hui dans le pays soit tellement vif qu’il peut paraître parfois suicidaire. Néanmoins, ont peut espérer que, quelle que soit la résolution de l’« impasse », cette conscience politique vénézuélienne prouve d’ores et déjà la possibilité réelle d’un mouvement démocratique dans l’Amérique du Sud de ce siècle.
[1] Chavistes et anti-chavistes.
[2] Ce terme désigne la période qui comprend les années 1973-1983. Cette période en précède une autre, très sombre, qui commence le 18 février 1983 avec ce qu’on appelle le « viernes negro » (vendredi noir).
[3] A l’exception du gouvernement illégitime de Pedro Carmona qui a duré quelques heures, après le coup d’Etat contre le gouvernement du président Chávez le 11 avril 2002.
[4] Partis social-démocrate et démocrate-chrétien.
[5] Jusqu’au vendredi 18 février 1983, le dollar valait 4,30 bolivars. Ce vendredi noir, la présidence publia un décret de suspension de la vente libre des devises étrangères. Le dollar est alors aussitôt passé à 14,30 bolivars.
[6] Arturo Uslar Pietri, De una a otra Venezuela, Monte Avila Editores, Caracas, 1992, p. II. Nous traduisons.
[7] La traduction de « clase baja » par « classe ouvrière » ne convient pas, car la « classe ouvrière » vénézuélienne est plutôt une minorité qualifiée, insérée dans le monde du travail légal. Cela veut dire que celle-ci constitue plutôt une classe « pauvre-pauvre » différente d’une classe « pauvre-indigente ». On ne peut pas appeler la « classe pauvre », « classe ouvrière » tout simplement parce qu’une grande partie de la population du Venezuela travaille de manière illégale. Nous dirons donc « classe pauvre ».
[8] Depuis 1958, année qui marque la fin de la dictature, les deux plus grands partis politiques vénézuéliens ont conclu un accord connu sous le nom de « Pacte du Punto Fijo ». Le but d’un tel accord consistait à limiter le plus possible l’opposition politique dans le pays, afin d’éviter que de véritables différences politiques se mettent en place dans une société qui commençait à peine à retrouver un équilibre démocratique. Mais au lieu d’empêcher le soulèvement militaire, ce pacte devint un mécanisme politique de pérennisation du pouvoir. Cf. Arturo Uslar Pietri, Golpe y Estado en Venezuela…, op. cit., p. 89-90.
[9] Tous les militaires ayant participé au coup d’État encourront des peines de prison. Le président d’alors, Carlos Andrés Pérez, s’enfuit ensuite du pays afin d’échapper aux poursuites judicaires pour corruption. Une des premières actions du président suivant, Rafael Caldera, sera la libération des protagonistes du soulèvement du 27 mars 1994.
[10] « Petróleos de Venezuela ». Entreprise nationale de pétrole.
[11] Partis qui, pour la première fois dans l’histoire politique du pays, ne parviennent même pas à atteindre cinq pour cent des voix.
[12] L’équivalent du M.E.D.E.F. en France.
[13] Arturo Uslar Pietri, Golpe y estado en Venezuela..., op. cit., p. 16. Nous traduisons.
martes, 1 de agosto de 2006
Suscribirse a:
Entradas (Atom)









.png)